Apaiser les mémoires et refonder les relations économiques
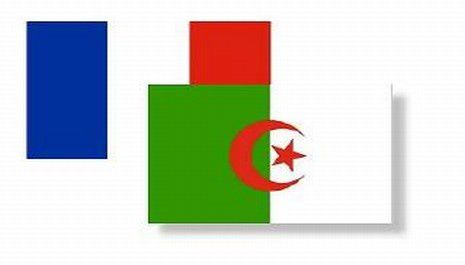
La visite qu'effectuera le président français, François Hollande, dans notre pays à partir de ce mercredi peut revêtir tous les caractères, sauf celui de la banalité. Très attendue des deux côtés de la Méditerranée, elle ne pourra pas, en revanche, régler tous les problèmes ni vider tous les contentieux qui pendent depuis des années entre la France et l'Algérie.
Au sein même des deux pays, et au-delà de l'ordre du jour officiel et de la solennité de la visite, des groupes politiques ou des franges de population ont des attentes et des ambitions spécifiques, voire même contradictoires, par rapport à la visite, et pour cause. La volonté de l'Algérie d'«arracher» une repentance de la France par rapport à la colonisation se heurte à des lobbies outre Méditerranée que le président français ne peut complètement ignorer. Le désir des anciens harkis, et particulièrement de leurs enfants, de se voir complètement réhabilités chez eux, dans l'Hexagone, au point d'établir des passerelles «sereines» avec l'ancien pays de leurs parents et faire «table rase» du passé, fait face à une réaction de refus légitime de larges franges de la société algérienne, au-delà même de la position des autorités officielles de notre pays.La visite de François Hollande tombe avec l'année de la célébration du 50e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie. Un demi-siècle au bout duquel – plus ardemment et moins sereinement que pendant les années 70 ou 80- les «histoires» de l'Histoire et l'expression du refoulé semblent peser de leur poids et sommer les acteurs actuels de se positionner par rapport à un livre d'histoire écrit dans la tourmente de la guerre de Libération.
Habituellement, les Algériens attendent de la gauche française plus d'égards et de gestes réparateurs que de la droite. Partiellement, cette attente est justifiée. C'est le maire de Paris, un grand cadre du Parti socialiste, qui a placé la plaque commémorative sur un pont de la Seine, celui-là même qui a vu des dizaines de corps d'Algériens, jetés dans le fleuve par les policiers de Maurice Papon un certain 17 octobre 1961, nager sans vie sous son tablier. Cependant, une partie du personnel de cette grande formation politique, le PS, ont participé, peu ou prou, aux souffrances du peuple algérien (rôle des ministères de l'Intérieur et de la Justice lorsqu'ils étaient sous les ordres de F. Mitterrand, vote à l'Assemblée nationale des pouvoirs spéciaux accordant les pouvoirs de police à l'armée sur le territoire algérien…). Quant à la droite, elle a souvent excellé dans un jeu «révisionniste» qui la rapproche de plus en plus de l'extrême droite. Les choses ont indéniablement empiré sous le mandat de Nicolas Sarkozy où les limites entre les deux obédiences sont devenues difficilement décelables. Les rapports que l'ancien président français avait nourris avec l'émigration, dont une très grande partie est d'origine algérienne, étaient empreints d'une tension et d'une méfiance exceptionnelles. Cela avait commencé au moment il où occupait le poste de ministre de l'Intérieur, lorsque la révolte des banlieues évolua presque en guérilla urbaine. La France officielle, hautaine, imbue de sa stature et trop sûre d'elle-même, découvrit une rébellion sociale, nouvelle version des anciennes, spontanée, contagieuse qui, tout en étant peu organisée, était animée par le même feu de la revanche des gueux.
La banlieue, thème récurrent des campagnes électorales françaises – dans le sens de sa diabolisation ou, au contraire, de sa magnification trompeuse par de fausses promesses – crache aujourd'hui sa colère et sa lave ignée contre les stratégies politiques qui ne se sont servies de ce dossier que comme arme de chantage électoral à dresser contre les adversaires politiques.
Le principe d'appuyer «là où ça fait le plus mal» est érigé en argument politique souvent payant dans l'immédiat, mais explosif à terme.
Héritages de la droite et de…la tragédie nationale algérienne
En prenant l'option risquée d'empiéter sur les plates-bandes de l'extrême droite – laquelle avait, auparavant, l'apanage de diaboliser la banlieue et le faciès étranger – la droite «classique» a perdu de son aura et de son crédit. L'on sait pourtant que ceux que l'on a pu injurier par le mot «racaille» est un pur héritage de l'empire colonial français. Du Maghreb, des anciennes colonies de l'Afrique noire, des Caraïbes, de la Polynésie – le tout sous la dénomination de DOM-TOM – les anciens peuples opprimés par le régime colonial français subiront les lois du nouvel ordre mondial qui feront concentrer la pauvreté, les maladies et le sous-développement dans les anciennes colonies. Le monde ne connaîtra de ces terres que les matières premières surexploitées par les multinationales, l'installation de certaines unités de production occidentales suite à des délocalisations dictées par la crise financière mondiale et, enfin, le marché de dizaines de millions de consommateurs, soutenus, comme en Algérie, par la rente pétrolière. Le revers de la médaille n'a pas tardé à voir le jour. Comme cela se produit depuis quelques années devant les yeux «attendris» des organisations des droits de l'homme, des cohortes de candidats à l'émigration subissent un sort humiliant, voire tragique aux frontières sud de l'Europe. Même la «ceinture de chasteté» qui a pour nom l'aide au développement n'a pas pu fonctionner comme il faut pour endiguer la chute aux enfers des peuples anciennement colonisés. Il faut reconnaître que, au désordre social et économique du monde moderne, se sont greffés – dans une relation intime et consubstantielle – les phénomènes de replis identitaires, de refuge dans l'extrémisme religieux et de terrorisme. Ce qui n'est pas fait pour pacifier les relations entre les Etats. C'est dans ce climat peu serein que François Hollande a accédé à la magistrature suprême en France. L'héritage désastreux de la droite le poursuit et la nécessité de dépasser les impondérables de l'histoire et de faire primer les relations d'intérêts avec des pays aussi importants que l'Algérie l'interpellent. Mais, comme à l'accoutumée, il est «écrit» quelque part que la visite d'un président français en Algérie ne peut pas bénéficier de toute la sérénité voulue. C'est le moment choisi en France pour «réactiver» l'affaire des moines de Tibhirine. Il est demandé à
F. Hollande de «faire pression» sur les autorités algériennes pour autoriser la relance de l'enquête. Il y a quelques semaines, un autre événement est venu tomber comme un «cheveu dans la soupe» dans les peu sereines relations algéro-françaises. Il s'agit du bras d'honneur brandi par l'ancien ministre de la Défense à la télévision face à l'idée de repentance de la France pour ses crimes coloniaux.
Du côté algérien, il y a lieu de nuancer. Même si l'unanimité de la condamnation du régime colonial n'a jamais fait défaut dans la société algérienne, la récurrente demande de repentance, formulée depuis ces dernières années, n'est pas cependant réellement portée par un courant très fort du fait que, à travers cette «procédure» visant officiellement l'ancien colonisateur, se cachent des desseins politiques «intra muros» inavoués visant un positionnement stratégique interne. D'ailleurs, même la demande de criminalisation de la colonisation, introduite il y a deux ans à l'APN, n'a pas eu de suite ; elle a même été «étouffée» par les autorités politiques en suggérant que le temps n'était pas «opportun» pour une telle procédure.
Comme on le voit, le poids de l'histoire ne cesse de ressurgir, même si le travail de mémoire commence à se faire d'une façon un peu plus détachée. Des historiens de valeur, en France et en Algérie, essayent de dépassionner le débat et de remettre la recherche historique sur les rails. Demeure un effort du côté de l'administration française: ouvrir la partie des archives qui demeure, jusqu'à ce jour, sous le sceau de la confidentialité ou du «secret défense».
Pour un partenariat gagnant-gagnant
Les enjeux des relations algéro françaises, au-delà des considérations liées à l'histoire, sont d'une dimension capitale, d'autant plus qu'un flux humain, à travers l'émigration algérienne qui a plus d'un siècle de présence sur le sol français, les irrigue et leur donne un peu plus d'humanité. De même, la proximité géographique, dans un bassin méditerranéen que de grands intellectuels et des hommes politiques des deux rives veulent rendre comme espace de paix et de coopération mutuellement bénéfique, ne manque pas d'imposer ses impératifs et de faire valoir une vision de rationalité. À 50 minutes de Marseille, Alger souhaite la vision qui fait prévaloir un certain pragmatisme allant dans le sens de relations non seulement apaisées, mais que pourra fructifier le capital de «familiarité» et d'histoire commune. La France, tout en demeurant un partenaire économique important, n'est plus seule sur la scène commerciale et économique algérienne. Elle est même supplantée et dépassée, dans beaucoup de secteurs, par de nouveaux partenaires (Chine, Corée du Sud, Turquie…), quasi inconnus chez nous il y a vingt ans de cela. Le projet d'installation de l'usine Renault de construction automobile dépassera-t-il, avec la visite de François Hollande, le stade de vœu ou le caractère de l'Arlésienne dans lesquels il est confiné jusqu'ici? D'autres créneaux, en dehors de la pure sphère commerciale, pourront être explorés avec les partenaires algériens, aussi bien dans l'industrie que dans les nouveaux créneaux de l'économie verte. Après s'être rendu compte que, en matière d'investissements, comme dans d'autres domaines de la vie, la nature a horreur du vide – car entre-temps des sociétés et entreprises asiatiques ou canadiennes ont «osé» s'installer en Algérie – la France a commencé à recentrer son intérêt pour notre pays depuis le milieu des années 2000, même si des observateurs de la scène économique sont convaincus que le volume des échanges et les créneaux d'intervention sont toujours en deçà des possibilités réelles. La gamme semble s'élargir à l'occasion de la crise mondiale qui a touché l'Europe de plein fouet depuis 2008, poussant des entreprises à des délocalisations forcées, parfois à 14 000 km de Paris.
Apaiser les mémoires, «pacifier» les relations politiques entre les deux pays, faire primer les intérêts mutuellement avantageux et un partenariat gagnant-gagnant, tels semblent les grands défis de la visite du Président français en Algérie.
Source Les Débats Saâd Taferka
Le Pèlerin