Langue française : ce butin de guerre mal aimé
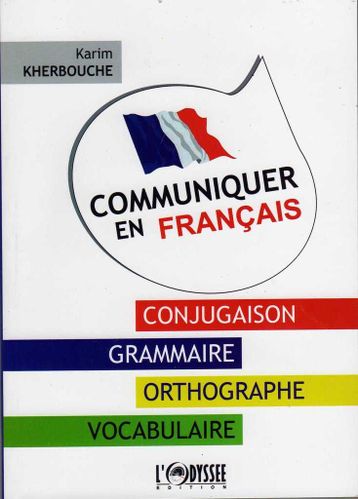
Les effets de la réforme sur l’enseignement des langues étrangères et, de façon plus précise, sur l’enseignement de la langue française ne sont plus à démontrer. Les enseignants et les spécialistes dressent un bilan sans complaisance du niveau de plus en plus bas de cette langue aussi bien chez les étudiants qu’au sein des enseignants. Les critiques actuelles dont fait l’objet cette discipline, nous renvoient aux interrogations que se posent tous les parents d’élèves sur l’utilité d’une réforme qui semble plus à même de générer l’échec que la réussite.
Adversité farouche
Recul - Depuis quelque temps, l’enseignement de la langue française connaît une régression sans
précédent.
Les raisons de cette décadence remontent au début des années soixante-dix «quand on décida
d’arabiser d’abord toutes les matières littéraires dont la discipline de base, la philosophie. Du coup, on n’a pas dispensé l’arabe en tant que langue véhicule de la culture et des connaissances
universelles, mais en tant qu’instrument de (revanche) sur la langue française considérée comme un héritage du colonialisme», écrit le journaliste Hamid Bouacida à ce sujet.
Feu Kateb Yacine disait que la langue française est «un butin de guerre». L’écrivain s’adressait à tous ceux qui lui reprochaient son choix quant à l’utilisation de cette langue dans ses
écrits.
Cette adversité farouche opposant arabisants et francophones par rapport au statut de cette langue, ne date donc pas d’aujourd’hui. Elle s’est manifestée déjà au lendemain de l’indépendance.
Ainsi, après avoir été l’instrument de l’enseignement durant des années, le français cédait peu à peu du terrain à la langue arabe qui a accaparé d’abord l’histoire et la géographie dans les
années 70 et le reste des matières telles les mathématiques, les sciences, et la technologie en 1975. Ce transfert n’a malheureusement pas été accompagné par des moyens didactiques et
scientifiques.
Et ce, notamment en direction de l’enseignement supérieur qui devait préparer l’encadrement nécessaire à cette réforme. L’échec de ce processus d’arabisation à tous les échelons est le facteur
principal de cette «régression féconde» pour reprendre l’écrivain Addi Lhouari.
Quand on pense que l’Algérie est le deuxième pays francophone au monde, on ne peut que se poser des questions devant le niveau qu’affichent nos universitaires tant en langue arabe qu’en langue
française.
Les projets entrepris jusque-là n’ont malheureusement pas pu concilier entre cette exigence multilinguistique et la qualité de l’enseignement. Une carence essentiellement perceptible à
l’intérieur du pays où l’enseignement du français est devenu presque une denrée rare. En effet, si la pratique du parler est plus ou moins sauvegardée dans l’Algérois et dans quelques wilayas du
centre, à l’intérieur du pays la langue de Molière ne semble plus avoir la cote. Pourtant, c’est cette même langue qui a donné une dimension universelle à l’élite algérienne faisant émerger des
noms de la dimension de Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, KatebYacine et bien d’autres encore. Cinquante ans après l’indépendance, c’est une preuve de plus que les politiques éducatives successives
ont failli à cette obligation de générer de la réussite et de l’intelligentsia.
Nos enfants ne maîtrisent ni l’arabe ni le français
«Quand je lis les devoirs de français de mon fils qui est en 1re année secondaire, option lettres, j’en
ai des frissons en comptant les fautes d’orthographe et de grammaire commises par l’enseignant. Qui va montrer ses graves erreurs à cet enseignant ?», s’interroge M. Bouacida déplorant le niveau
de la nouvelle génération dans cette matière.
Pour lui, c’est tout le système qui est en cause avant de rappeler que celui-ci «après avoir constaté les dégâts de l’arabisation menée à la hussarde dans les années 70, confia l’Education
nationale à une sommité, le défunt Mostepha Lacheraf qui dut vite rendre les armes suite à d’intenables pressions». «Juste après lui, on entama l’école fondamentale avec les résultats
catastrophiques qu’on sait. Depuis plus de trente ans, nos enfants ne cessent d’être les cobayes de laborantins qui n’ont aucune prise sur les réalités universelles et au lieu de s’ouvrir sur le
monde en instituant l’enseignement de plusieurs langues, on continue à professer l’usage unique de l’arabe, laquelle langue est idéologisée à l’extrême», tient-il à préciser.
C’est pour cela qu’on a, selon lui, «omis d’enseigner la langue arabe dans toute sa beauté en n’en retenant que les référents idéologiques.
Quand on lit le Coran, on découvre ‘’l’intraduisibilité’’ du Texte et toute sa force, sa portée philosophique, sa poésie, sa syntaxe… Lisez un poète comme Adonis ou Nizar Kebani : on découvre
toute la beauté d’une langue confinée hélas à des idéologies et règlements de comptes, donc vidée de sa ‘’substantifique moelle’’».
Recyclages, encore des recyclages…
Ils sont 4 300 enseignants de langue française, dans les écoles primaires issues de 14 wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux à bénéficier de stages de formation et de perfectionnement linguistiques et pédagogiques d’ici à 2014. «Un dispositif de formation, qui s’inscrit dans le cadre du
parachèvement de la réforme du système éducatif dans le but de renforcer les compétences académiques et professionnelles de l’ensemble des enseignants, particulièrement les enseignants de langue
française dans les zones du sud et des Hauts-Plateaux», a indiqué le directeur central de l’enseignement fondamental au ministère de l’Education nationale Brahim Abassi. Une initiative qui
confirme le problème que pose l’enseignement de cette langue de qualité de moins en moins satisfaisant. Ces maîtres et ces maîtresses se voient pourtant imposer la responsabilité de bien la
maîtriser.
Une chose est sûre, au regard des témoignages recueillis, «la maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit a fortement régressé. Les nouveaux enseignants ne maîtrisent malheureusement ni l’un
ni l’autre», affirme Mme Souad M., enseignante à l’école primaire de Dergana I, dans la commune de Bordj El-Kiffane. Elle affirme dans ce contexte que «les jeunes licenciés en langue française
sont orientés automatiquement vers l’enseignement sans aucune formation pédagogique au préalable. Ce n’est donc pas leur faute», atteste-t-elle. Ce manque de formation a porté un coup fatal à la
qualité de l’enseignement de cette langue. «Dans l’ancien système un élève de sixième année était capable de rédiger un paragraphe. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il faut dire que trois
heures par semaine ne peuvent, en aucun cas, répondre aux besoins d’un enfant de huit ans en matière d’apprentissage d’une langue», souligne Mme Souad M. dans l’enseignement depuis 32 ans. C’est
donc cette réalité longtemps occultée qui a poussé les pouvoirs publics à lancer ce projet «Remédiation linguistique du français dans le Sud algérien». Celui-ci «vise à former des pôles de
trinomes, à savoir deux enseignants et un inspecteur de formateurs, pour la démultiplication de la formation de l’enseignement, afin de remédier aux insuffisances au niveau des pratiques en
classe de langue française», précise le département de M. Benbouzid.
Les carences de l’enseignement
Impératif - Quelle que soit la discipline enseignée, le maître d’école doit disposer d’un savoir-faire
et d’un pouvoir à même de lui permettre d’être responsable du groupe d’élèves qui lui est confié.
Loin de cet idéal, l’enseignant de langue française est aujourd’hui «incapable de guider,
intéresser ou s’imposer. Il est, par conséquent, difficile pour lui de se faire accepter ou même d’être reconnu dans ses compétences d’enseignant», atteste Mme Ouiza Naït Achour enseignante de
langue française depuis 1969. «Il ne peut utiliser ni son expérience, ni son savoir-faire, ni même sa conscience.
Il doit plaire à l’élève et au chef», confie-t-elle. Elle regrette dans ce contexte les restrictions qu’a connues la plage horaire réservée à la langue française. «Les réductions qu’a connues
l’emploi du temps de cette discipline, ont largement contribué à compliquer l’apprentissage de cette langue. Alors qu’il était de 600 h par an il y a à peine quelques années, il est de 420 h par
an aujourd’hui, et ce, pour un enseignant qui ne s’absente jamais. Ce qui relève presque de l’utopie en Algérie», dit-elle en remettant en cause le nouveau programme.
Celui-ci aurait, contrairement à l’ancien système, banni complètement «la méthode syllabique et les quatre formes d’écriture, (minuscule, majuscule, l’écriture scripte et cursive). La nouvelle
méthode n’insiste pas non plus sur les points de langue qui sont : la grammaire, la conjugaison, l’orthographe et le vocabulaire.
Et pour couronner le tout, on a même supprimé les cahiers de classe, histoire de ne pas contrôler les élèves régulièrement», déplore notre interlocutrice qui, à maintes reprises, a eu des
différends sur ce point précis avec les inspecteurs du ministère de l’Education.
Notre enseignante qui a failli perdre la vie pendant la décennie noire, persiste et signe : «La nouvelle méthode n’apporte rien à l’élève. Ce dernier arrive à l’université avec une faible base en
langue française. Pourtant, c’est avec cette langue qu’il est appelé à suivre les cours des matières scientifiques et technologiques.»
L’enseignant a le devoir de faire progresser ses élèves dans sa discipline selon un programme préétabli. Pour en arriver là, encore faut-il que l’enseignant ait une maîtrise parfaite de cette
langue. «Le niveau est faible.
Ce qui manque aux enseignants c’est la maîtrise d’application. Dans le passé, le maître d’application avait pour mission de présenter des leçons modèles pour que les enseignants apprennent à
mieux enseigner. A présent, ces leçons ont disparu laissant libre cours à l’enseignant de préparer avec ses propres élèves la leçon qu’il présentera à la réunion pédagogique», déplore-t-elle
avant de revenir sur le rôle des parents. «On critique souvent les enseignants, mais jamais ceux qui préparent les programmes.
La plupart des parents ont trouvé la parade avec les cours particuliers et les écoles privées.
Pour les autres c’est l’école publique avec ses avantages et ses inconvénients. Ne pas oser aborder cette question et affronter les conséquences de ce nouveau programme n’est pourtant pas une
solution. Car c’est aux parents qu’il revient de préparer l’avenir de leurs enfants, être bilingues ou arabisants.
Puis il faut donner le même enseignement à tous les Algériens. Pourquoi les enfants de la haute classe font tout en langues étrangères ?», s’indigne Mme Naït Achour qui rend un vibrant hommage au
doyen des enseignants algériens de langue française Mustapha Haloune. «Ce dernier a formé des générations entières auxquelles il a transmis l’amour de cette langue», témoigne son élève.
Ali Hamid Bouacida* à InfoSoir
«Vouloir remplacer le français par l’anglais, c’est absurde»
Propos recueillis par Assia Boucetta
InfoSoir : Que reproche-t-on à la langue française pour être la première cible à chaque réforme scolaire ?
A. H. Bouacida : La langue française est décrite comme «une dame belle et élégante», selon l’un des chantres de l’arabisation, feu Tahar Ouettar. En effet dans leur perception de la langue
elle-même, la plupart de ceux qui la fustigent lui reconnaissent une textualité et une esthétique incomparables. Mais ils se gardent de l’utiliser lui préférant un arabe châtié plus proche des
pratiques linguistiques moyen-orientales que celui de l’Algérie, une langue parlée, brassant tous les dialectes de la Méditerranée.
On parle d’incompétence et d’insouciance des nouveaux enseignants de langue française.
Qu’en pensez-vous ?
Les enseignants ne sont pas totalement responsables de cette situation. Sauf qu’un enseignant qui décide de se consacrer à apprendre le français à des élèves, doit, en son âme et conscience,
lui-même en faire le long et laborieux apprentissage en recourant à la lecture. Emmanuel Kant disait qu’il «faut tout lire, de la gazette du soir au traité de philosophie le plus complexe». Il y
a en ce moment une floraison de talentueux romanciers algériens dont les ouvrages sont largement disponibles dans toutes les librairies. Alors pourquoi ne pas concevoir des devoirs et des études
de textes extraits de ces œuvres puisées dans notre terroir et notre quotidien, au lieu de ces textes «importés» qui n’ont aucune importance pour l’élève? C’est parce que les enseignants ne
lisent pas et la plupart ne cherchent pas à améliorer leur niveau. Mais faut-il leur en vouloir en ces temps «alimentaires»?
Certaines parties veulent même supprimer cette langue pour la remplacer par ce qu’elles appellent la langue universelle (anglais)
Remplacer le français par l’anglais est une manœuvre ridicule qui fut d’actualité un certain temps avant que ses initiateurs mêmes ne se rendent compte de son caractère ubuesque. Parce que le
français, étant la langue du colon, on le remplace par l’anglais pour la seule raison que la Grande-Bretagne, empire colonial lui aussi, ne nous a pas colonisés ? Mais alors pourquoi ne pas
renforcer l’apprentissage de ces deux langues au lieu de chercher à remplacer l’une par l’autre ? Les auteurs d’une telle absurdité s’imaginent qu’on peut remplacer une langue comme on change de
fournisseur de poudre de lait ou de viande.
La plage horaire réservée à cette langue est loin d’être satisfaisante selon les
enseignants. Pourquoi les autorités ne réagissent-elles pas ?
L’introduction de plus grandes plages horaires consacrées à la langue française, est une décision plus politique que pédagogique. Son enseignement répond donc à des considérations idéologiques
sur fond de commerce dont sont bénéficiaires les plus rétrogrades des forces qui régissent l’Education nationale et Dieu seul sait qu’ils sont nombreux. Parlez-leur de Kateb Yacine, celui qui
décréta très justement la langue française comme un «butin de guerre», ils vous rétorqueront aussitôt que c’était un mécréant. Et c’est là que réside le grand malentendu de notre école où on est
en train de former des croyants au lieu de citoyens prêts à s’adapter à toutes les situations.
A. B.
* Journaliste et écrivain, lauréat du prix littéraire Mohammed-Dib en 2006
Source Infosoir Assia Boucetta
Le Pèlerin